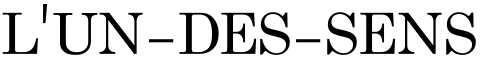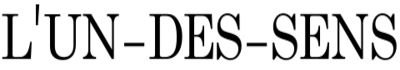La Foi
Définition :
La foi, est un phénomène indescriptible dans son intégralité, pour tenter de la définir partiellement, il serait plus aisé de commencer par dire ce qu'elle n'est pas.
Ce qu'elle n'est absolument pas : une croyance, une doctrine, un mode d'emploi, recette, ignorance, naïveté, rien de tout cela !
Elle est avant tout, une faculté qui exprime : l'humilité, confiance, lucidité, assurance, sincérité, conviction, créance, optimisme...
Pour l'essentiel, l'intellect fait l'amalgame entre la foi et la croyance, en tant que croyance elle peut être aveugle, ce qui est irréfutable.
Or, cet amalgame intellectuel est lier au langage qui exprime une subjectivité lier à une croyance, si les religieux en raison de l'histoire, ce sont approprier le terme et ériger en norme. Il en est tout autant pour les religions du paganisme, des philosophies, des sciences, etc, toutes les disciplines fonctionnent selon leurs propres adeptes, leurs propres partisans, groupes, public, courant de pensées, etc.
Pour résumé, l'activité cérébrale par l'intellect est orientée pour l'essentiel, par une croyance quelle qu'elle soit la discipline, c'est la conviction.
Par principe, la vie est subjective, la diversités d'opinion, d'avis, de visions, tout ce réfère à une croyance, même si elle est érigé en vérité, elle n'est qu'une fraction, or le réel se veut absolu, donc entier...
Les croyances
Selon les dictionnaires, ici le Larousse : la croyance, (ancien français creance, du bas latin *credentia, du latin classique credere, croire), est le fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse : La croyance en Dieu, aux fantômes.
Synonymes : adhésion - assentiment - certitude - conviction,etc.
Selon Wikipédia : La croyance est le fait d'attribuer une valeur de vérité à une proposition ou un énoncé, indépendamment des éléments de réalité confirmant ou infirmant cette proposition ou cet énoncé.
Étymologiquement, croyance, provient du mot croire (du verbe latin credere) qui partage sa racine avec croître. Croître, se définit comme ce qui élève, évolue, se développe, une croissance ou fait grandir (la grandeur) au sens noble du terme, c'est à dire au niveau le plus haut, ce qui tend vers la perfection.
Dans le langage courant, une croyance est synonyme de : avis, idée, opinion, pensée, position, sentiment, thèse, point de vue, idéologie, etc.
C'est une conviction fourre tout, elle se compose de tout type d'argument pour la justifier (être juste) : être sérieux, rationnel, pragmatique, réaliste, conscient, lucide, l'évidence, etc. Pour étayer cette justification, le recours à ce qui est contraire à cette vérité est désigner en ces termes : rêveur, frivole, délire, fétichiste, superstition, fantasmes, etc.
Le terme rationnel semble le plus concis pour définir au mieux la croyance par l'usage de la raison, cependant, ce n'est qu'une fraction de l'intégralité qu'est le réel, c'est un entier qui contient des parties, autrement dit, le réel, est plus que la somme de ces parties.
Pour l'essentiel, la conscience navigue entre ignorance et lucidité, entre l'invisible et le tangible.
Lorsque l'ignorance s'aventure dans l'invisible, comme dans le tangible, c'est toujours une naïveté et un vice.
Le réel ou réalité
Le réel et son féminin réalité ( principe de genre de la vie), dans leurs définitions sont la référence suprême, celle qui atteste d'une vérité, ils servent de guide a cette même vérité. Or, le réel comme la réalité sont un entier, ils contiennent toutes les polarités et toutes les fractions, le visible comme l'invisible, l'abstrait comme le concret, la vérité et le mensonge, le vrai comme le faux, le bien et le mal, le beau et le laid, l'amour et la haine, l'injustice comme la justice, etc.
Le mental humain est disposé selon une ternaire et sa mécanique de fonctionnement est : pensée, parole et action il est constitué par des disciplines avec les plans qui leurs correspondent :
| sensoriel (corps organique) | intellectuel (corps mental) | spirituel (corps mental) |
|---|---|---|
| les sciences | les philosophies | les religions (lecture et relation) |
| les matières premières | les techniques (méthodes) | les arts (méthodes) |
Rejeter une fraction de cette réalité et quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit la croyance et quelle qu'en soit la valeur, est un déni.
La polarité, ne peut être supprimé ou modifier, c'est un principe immuable et éternel, vouloir plus de bien au nom d'un sens morale est légitime et respectable, mais le mal sert de tension pour que la conscience puisse faire un choix, soit évoluer ou involuer, progresser ou régresser, etc. C'est de cette tension que naît le libre arbitre avec sa corollaire qu'est la Liberté.
Il est utile pour l'apprentissage de la valeur, que l'enfant et l'adulte, ne puissent voir le même bien ou le même mal.
Bien qu'un enfant soit avertit (savoir), il comprend le danger du feu, ce n'est que lorsqu'il fait l’expérience pour la première fois, qu'il va assimiler la douleur causé par la brûlure de ce feu.
Le feu comme toutes choses, n'est pas responsable de notre douleur physique et de la souffrance mental, c'est notre approche et la valeur que nous leurs octroyons qui les rend bonnes ou mauvaises et je ne peux connaître la valeur d'un "bien" sans passé par la case du "mal".
Le fractionnement, lier à notre activité intellectuelle pour tenter de comprendre, divise toujours et de plus en plus, et ce dans toutes les disciplines.
Les exemples sont foison, il y a presque 2 500 ans que l'hypothèse de l'atome insécable du philosophe grec Leucippe et son disciple Démocrite était sensé être la base de la matière, serait le socle qui unirais une compréhension définitive de toutes choses, deux mille cinq cent ans plus tard, après que THOMSON, Joseph Dalton en passant par Michael Faraday et Julius Plucker ont étudiées et confirmer l'existence de cet atome par l'expérience scientifique et suite aux travaux d'Henri BECQUEREL, Pierre et Marie CURIE ont découvert que cet atome l'on croyait initialement être des particules élémentaires (le mot « atome » signifie insécable en grec), était en réalité divisibles, la recherche se poursuivant, on découvre tout un nouveau monde, celui de l'infiniment petit (subatomique) avec lui une nouvelle discipline scientifique, celle de la physique Quantique, ils découvrirent qu'au sein d'un atome, une multitudes de particules et d’interactions entres-elles, forment des combinaisons multiples. Ces particules dites élémentaires et leurs antiparticules, a ce jour, représente plus d'une soixantaines, et ce n'est pas fini. La biologie et le génome, la physique et le big-bang, etc, sont un gouffre sans fin, vers toujours plus. Comprendre le fonctionnement par le comment est une démarche importante, mais ça ne répond toujours pas à la question du pourquoi ?
L'acceptation, que l'on ne sera ni connaîtra jamais l'intégralité du réel tel qu'il est, tant sa complexité rend le terme lui même plus facile à comprendre, que l'humilité de savoir que l'on ne sait rien, est l'unique vérité en pareil situation.
La polarité
La polarité est un principe, se présente à l’image de l’atome, comporte un pôle positif et un pôle négatif, un aspect
féminin et masculin, actif et passif, un certain niveau vibratoire...tout dans la création possède ces propriétés. Le bien et le mal, l’ordre et le désordre, ne sont pas séparés, ils sont en toute chose et en chacun d’entre nous au niveau principe et causal, c’est la
base du libre arbitre. Pour choisir le bien, il faut que le choix du mal soit possible et constamment disponible, le négatif et le positif, le chaud et le froid, le sec et l’humide, le lourd et le léger, la lumière et les ténèbres etc.
Chaque Conscience exercera sa liberté dans le cadre des lois de causalité. Tout est possible, mais l’action implique une réaction, c’est la
règle ! Cette réaction sera positive ou négative en rapport et compensation de l’action, c’est la Loi qui gouverne le libre arbitre du divin processus.
Notre jugement, dont la balance est le symbole de la justice, comporte deux plateaux (la polarité), leurs équilibres se lit lorsqu'ils sont au même niveau, c'est le zéro du thermomètre. Sitôt, que l'on dépose sur l'un des deux plateau le fait à mesurer (juger), nous créons mécaniquement son déséquilibre.
Si, l'on met du mal sur l'un des plateaux, mécaniquement le plateaux opposé qu'est le bien se hisse vers le haut.
Sachant que, sur l'échelle de la création, le bas est lourd et le haut plus léger, autrement dit, le mal s’enfonce davantage dans l'obscurité de la terre.
Tandis-que, le léger s'envole vers les cieux... C'est une vision pur de ce qu'est la mécanique, celle de la balance ou le léger ne fera jamais le poids face au lourd. D’où, les tenants de la matière auront toujours raison, tant qu'il s'agira de peser de la matière.
Dans notre quête de la connaissance, pour éviter de sombrer dans la lourdeur et la rigidité, nous nous référons aux vertus.
La première vertu se nomme Humilité, qui exprime notre insuffisance de la connaissance, elle nous rappelle notre devoir à accomplir.
Là ou l'intellect égotique revendique des droits, ceux d'agir comme bon lui semble, au prétexte qu'il sait et comprend.
La foi
La foi, dans son essence, n'est pas simplement une croyance en l'invisible ou une confiance aveugle.
Son origine latine, "fides", évoque un état de conviction, une certitude inébranlable.
Dans la vision moderne, la foi est souvent associée à l'espoir, mais l'espoir laisse la porte ouverte au doute.
La vraie foi, la conviction, ne laisse aucune place à l'incertitude.
Elle est la force qui transforme les rêves en réalité tangible.
c'est une conviction profonde, le fondement sur lequel se bâtissent les réalités.
Lorsque vous cultivez une conviction interne inébranlable, vous n'espérez pas seulement un changement, vous le créez.
La foi est aveugle, comme le dit si bien l'expression consacré par les idéalistes en tout genres du tangible.
Si l'on se tiens uniquement à cette définition, n'est vrai que ce qui est visible, donc, mesurable, l'argument est irréfutable...
Ne serais-ce pas un déni de tout les handicapés de la cécité, sont-il des êtres qui vivent uniquement de l’irréel ?
Vivrions-nous uniquement le jour, que la nuit et son obscurité nous interdirait toutes sorties au prétexte que l'on ne voit rien ?
La terre incognita, est totalement inaccessible à la raison qui a besoin d'un repère connu pour pouvoir agir...
Le seul moyen qu'a la Raison d'évoluer, c'est celui qui consiste à recevoir des informations nouvelles en provenance de la Foi.
La foi, c'est avant tout l'intuition et l'illumination et autre axiome.
La nouveauté est tout le temps perçut par la raison comme une absurdité, mais au fur et à mesure que s'ajuste la vision sur la réalité de ce qui est nouvellement perçu, elle devient de plus en plus raisonnable et raisonnée, pour devenir une certitude ; faisant ainsi passer ce qui était du domaine de la Foi à celui de la Raison que la démarche de cette Foi est venue féconder et enrichir.
La Foi est donc l'incontournable facteur qui permet l'évolution. C'est ce qui est à la base de la perfectibilité.
Lorsque nous nous trouvons face à un problème non répertorier dans la mémoire, le mental continue son travail habituel, il cherche, analyse, compare... La vérité, c’est qu’il ne peut mettre en relation cette sensation étrange avec aucune autre. Il a beau chercher dans sa base de données, rien ne correspond, aucun état connu qui s’approche de celui-ci, aucune expérience équivalente à mettre en balance pour savoir quoi faire...
En fin de compte, tout ce qu’il arrive bien malgré lui à trouver, ce sont ses limites.
Lors, d'un déplacement en voiture de nuit, la visibilité par les phares n'est que d’environs une centaine de mètres, de qu'elle preuve disposons nous pour continuer à avancer dans le noir ? Certes, il existe des plans qui attestent de l'existence de cette route...
Mais, étant donné que l'on est pragmatique et un tantinet sceptique, voir méfiant, qu'est ce qui prouve que cette route est sûre, n'a t'elle pas était endommagé, qui sont ces gens qui l'ont tracer sur le plan, je ne l'ai connaît pas, ne suis-je pas prudent de me poser la question, voir de ne pas l’emprunté la nuit ?
La raison, notion de sagesse de l'intellect, me rappelle, que ma logique est stupide. De même, que suite à une fin de journée de travail, la phrases suivante "a demain" est prononcer sans aucune réflexion, faire des projets, de vacances, d'anniversaire, etc, sur quoi repose cet énoncé, ce ne sont que des probabilités malgré tout, ne font-il pas appelle à une certaine confiance qui n'est que la filiation de la mère foi ?
L'abstraction est invisible, nulle carte, nulle logique, nulle certitude cartésienne, seule un aveugle peut se diriger dans un tel concept.
Si dans notre réalité visible, l'aveugle utilise les sons et l'air pour mesurer les obstacles qui sont de réel épreuves pour lui, dans le réel commun, les cinq sens sens ne suffisent pas à se localiser dans la vie !
La Raison tire sa force de ses certitudes, sa logique, ses mécanismes de fonctionnement causaux, mais ils sont efficaces et opérants uniquement sur un territoire balisé, connu, et avec une faune de pensées identifiées et identifiables...
En dehors de ces limites, qui sont très étroites puisqu'elles ne concernent que l'espace dans lequel les sens organiques sont opérationnels, la Raison rapidement déraisonne et affabule, car la Raison sans ses repères, encore plus rapidement que ce qu'il en est pour la Foi, devient aussi délire et folie.
La Raison n'aime rien de moins que la Terra incognita, elle est invariablement hostile à ce qui pour elle est le début de l'étrange et de l'inassimilable, et pour s'en protéger elle dresse à ses frontières des remparts, qu'elle voudrait inviolables, mais qui ne sont que des artefacts qui limitent considérablement ses champs du possible.
l'intolérance et le sectarisme reposent sur la certitude d'avoir Raison contre ceux qui ne pensent pas comme vous, et sans l'ombre d'un doute, ce n'est là que l'expression de vices dont celui de l'ignorance n'est pas des moindres.
Conclusion
La croyance exige des preuves pour poursuivre une voie, alors que la foi en a pas besoins de ces preuves, elle est certaine de celle qu'elle suit...
Le seul moyen qu'a la Raison de croître, c'est celui qui consiste à recevoir ses nourritures vitales de la Foi qui part les quêter dans cet espace inaccessible à la Raison que sont l'intuition et l'illumination. Au départ ce qui est rapporté paraît absurde et inexploitable, mais au fur et à mesure que s'ajuste la vision sur la réalité de ce qui est nouvellement perçu, d'absurde, elle en devient de plus en plus raisonnable et raisonnée, pour devenir certitude ; faisant ainsi passer ce qui était du domaine de la Foi à celui de la Raison que la démarche de cette Foi est venue féconder et enrichir.
La Foi est donc l'incontournable facteur qui permet l'évolution. C'est ce qui est à la base de la perfectibilité.
Lorsque nous nous trouvons face à un problème non répertorier dans la mémoire, le mental continue son travail habituel, il cherche, analyse, compare… La vérité, c’est qu’il ne peut mettre en relation cette sensation étrange avec aucune autre. Il a beau chercher dans sa base de données, rien ne correspond, aucun état connu s’approche de celui-ci, aucune expérience équivalente à mettre en balance pour savoir quoi faire… En fin de compte, tout ce qu’il arrive bien malgré lui à trouver, ce sont ses limites.
La foi, trace la voie au fur et à mesure de sa démarche. Analogiquement, la croyance, pour poursuivre un chemin exige qu'il soit éclairer, alors que la foi éclaire cette même voie...
D'une certaine façon, exiger une preuve, c'est refuser d'avancer; prendre l'avion, c'est exiger des certitudes sur les capacité du personnel à bien assumer leurs métiers, du pilote au personnels au sol, tous doivent me fournir des preuves de leurs capacités à maîtriser un vol, on me dit qu'ils ont leurs diplômes, oui mais moi je ne sais pas dans quelle condition ceux-ci l'ont obtenue, etc.
Ceci, pour dire que sombré dans la paranoïa raisonneuse, ne fait pas avancer le Schmilblick...
La Foi est ce qui permet d'explorer ce qui se trouve au-delà de ce qui est admissible à la Raison, elle est donc nécessairement séparé par la frontière délimitant la connaissance de l'ignorance.
Il faut un minimum de Foi pour que la Raison avance, sinon comment croire que ce que nous dit l'enseignant est vrai...