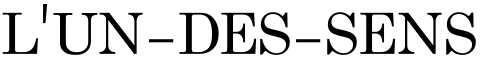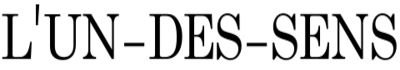Le Don
Introduction
La définition, du don dans l'inconscient ou conscient collectif est une caractéristique que l'on reçoit par héritage à la naissance, serait donc une qualité innée par opposition à l'acquit. Et par surcroît, seule quelques élus par dame nature en auraient, pour les autres passer votre chemin...
Le don est assimiler à un talent technique, un savoir faire et si l'on est un heureux élu de l'avoir reçu, il faut le monnayer pour en tirer un profit, ce n'est point logique tout ça !
Avec un brin d’honnêteté, si l'on reçoit quelque chose, le minimum serait de remercier le donateur... A moins d'adopter une attitude de celui qui trouve un objet de valeur par terre, le ramasser, sans se soucier, ni vérifier si son propriétaire est dans le périmètre ou le rapporter au centre des objets perdus... Et d'en faire sien et de s'en vanter sans aucun mérite.
Qu'en est-il vraiment?
Il y a une part de vérité dans cette affirmation : qu'elle est une propriété qui est de l'ordre de l'inné, que l'on reçoit lors de la naissance. Cependant, elle n'est point, exclusive et dans tout les cas, elle s'avère universelle.
Inné ou acquit
 Ce débat qui avait duré quelques siècles entre les philosophes, scientifiques et tout penseur, pour savoir si le patrimoine intellectuel, artistique ou toute qualité, était reçu lors de la naissance ou bien, était acquis par la force du travail et la volonté de l'individu.
Ce débat qui avait duré quelques siècles entre les philosophes, scientifiques et tout penseur, pour savoir si le patrimoine intellectuel, artistique ou toute qualité, était reçu lors de la naissance ou bien, était acquis par la force du travail et la volonté de l'individu.
Comme toujours dès lors que nous classons les thèmes et ce, quelles qu'ils soient, à l'intérieur des cases, des catégories, etc. Nous les amputons des liens qui animent leurs missions ou objectifs.
Bien sûr, effectuer cette démarche dans le cadre d'une recherche sur un sujet en particulier, est tout à fait normal et même indispensable, mais il ne faut pas oublier à la fin de cette démarche de remettre les choses dans le contexte qui était le leurs, pour rétablir les liens (lire l'article) existants avec leurs milieux.
Surtout, cela permet de mieux comprendre, que l'on ne peut pas voir toute les interactions du sujet, ou la chose qu'importe le nom de ce que l'on analyse, avec son environnement. Une belle plante que l'on étudie au milieu d'une forêt, ne peut être tout à fait la même sur votre balcon, un individu au milieu des siens ne peut être le même au contact d'autres personnes, en raison de l'interaction qui s'exerce avec son milieu, car le milieu le nourrit ou l'appauvrit en permanence.
Mais quel est le rapport avec le don ?
L'inné : le don, est une qualité que nous recevons tous à notre naissance et il est et sera toujours en nous jusqu'à la fin d'une vie.
Il est important de ne pas oublier notre particularité, ce sont les attributs qui forment notre personnalité, par le fait, c'est ce qui nous rend unique, nous disposons donc d'un don unique, et on ne peut avoir celui de l'autre...
L'acquit : Un don ça ce cultive, comme l'est la cultivation du blé, plus nous le cultivons plus nous en possédons, donc en le développant, on l'acquiert.
Le fait de comprendre, renforce en nous la sensibilité ou le sentiment de foi (lire l'article) ou de confiance et nous libère de notre jugement et le jeu des comparaisons...
En ce monde féru de réalisme matériel, il est difficile de comprendre qu'il existe une sphère spirituelle, dans laquelle nous avons déjà reçu, car, le tout est en nous, un don universel qu'est celui de : Donner ou Don-née pour l'assimiler, il faut développer la capacité à recevoir.
Ce n'est que lorsque, l'on donne de façon désintéressée que l'on découvre son équivalent qu'est celui de recevoir en nous.
Rien n'est donc à démontrer... en revanche tout est à faire du côté de notre capacité à savoir recevoir...
Le Dévouement par le Don
Entrer dans le monde du dévouement, du don et du service désintéressé, et sortir du monde du commerce, de l’échange et du rapport de force.
Pour entrer dans le monde du dévouement et du don du service désintéressé, il faut nécessairement traverser les champs du sacrifice.
- - Sacrifier la satisfaction orgueilleuse et le besoin de considération vaniteuse de l’ego qui veut sans cesse qu’on lui rende l’hommage qu’il croit lui être dû, que ce soit pour ce qu’il s’est approprié comme sien (sa propre création).
- alors qu’il ne s’agit que d’un emprunt a autrui, dans le meilleur des cas, et d’un pillage éhonté dans le pire, ou pour la gratitude qu’il pense légitime de recevoir en retour de son action, compte tenu du profit que peut en faire le bénéficiaire. - - Sacrifier ses certitudes artificiellement édifiées sur les bases du savoir et non sur les bases de la Connaissance.
- Sacrifier le confort paresseux de l’ornière des routines et d’une rassurante et illusoire normalité ambiante.
- Sacrifier toute attente de résultats immédiats positifs suite à son don, sans pour autant cesser de servir.
- Sacrifier tout intérêt, matériel ou intellectuel, personnel qui pourrait résulter du service effectué.
- Toutes idées de possession et d’accaparement matériels, intellectuels et/ou spirituels. Celui qui s’approprie et possède est approprié et possédé par ce qu’il possède. - - Sacrifier, en toute connaissance de cause, le temps et l’énergie vitale nécessaire pour donner une consistance et une densité à ce service désintéressé, tant dans la constance que dans sa structure cohérente.
- - Sacrifier toute idée d’aliénation ou d’asservissement, même la sournoise idée de reconnaissance que devrait recevoir le serviteur désintéressé, car toute dépendance lie autant le débiteur au créancier et inversement, les privant l'un et l'autre de liberté.
- - Enfin, et peut être le plus difficile, sacrifier l’idée même de sacrifice, car une fois dépassées les limites des champs du sacrifice, l’officiant, qui se dévoue pour la vie, la nature, la création, obtient la libération des servitudes que lui impose l’espace ou règne le commerce, la possession, la cupidité, l’avidité, la dissimulation, le rapport de force et de domination et, par voie de conséquence, la violence des pensées, des paroles, des actes et des rapports à autrui, tout ce qui est interconnecté aux lois causales.
Ce n’est que lorsque l’officiant s’affranchit des contraintes du commerce des sens et des émotions, ainsi que des servitudes du sacrifice, qu’il accède à sa propre liberté et au pouvoir de l’énergie du service désintéressé, celui qui donne accès aux champs des relations multidimensionnelles de la création Divine, et dont la seule monnaie ayant cours légal est uniquement celle du Don.
La providence de la Divine création est uniquement réservé aux Consciences libres, et seul le service désintéressé libère des lois de causalité.
Donner, donner et encore donner ! Un bon moyen de se libérer de la peur du manque est d’aller à l’opposé de sa peur en donnant.
Une personne avec un état d’esprit d’abondance n’a pas peur de donner, car elle sait qu’elle recevra encore plus en retour – et sous différentes formes.
Cela peut passer par donner des avis positifs sur des services ou entreprises que l'on apprécie, donner de l’amour et de l’affection à ses proches, donner de l’argent (même symboliquement) à des personnes dans le besoin, etc.
L’état d’esprit d’abondance permet de voir les opportunités là où d’autres ne voient que les contraintes, de profiter du moment présent en étant reconnaissant·e de tout ce que l’on a déjà, et de libérer son potentiel en trouvant des solutions innovantes pour atteindre ses objectifs.
Et la magie dans tout ça ?
Et bien elle est dans le mécanisme décrit dans le monde économique.
Dans le commerce, vous faites donner (un don) d'une somme d'argent et vous recevez en retour l'objet désiré.
Dans la vie à chaque fois que vous faites un don de quelque chose, il vous sera retourné, vous recevrez une chose en retour.
Son secret est justement qu'il en est un, à savoir, qu'en guise de retour à votre don, la vie ne mentionne pas sous forme de papier que l'on appelle un reçue, la raison, la nature de l'objet et le nom de son fournisseur, c'est à nous de le comprendre. Nous recevons toujours, ce dont on a besoin et au moment même ou en a vraiment besoin.
Le fournisseur n'est autre que la vie, ne jamais oublier qu'elle est une âme créatrice et elle est l'abondance sous la forme du don, dans la nature, un arbre donne ces fruits sans rien exiger en retour.
De cette règle qu'est, l'équilibre, on entend souvent dire d'une porte qui se ferme, une autre s'ouvre, un handicap reçu, un autre sens émerge etc.
C'est ce que l'on appelle la compensation, du verbe compenser, de là provient la ré-compense que l'on touche lors d'un don.
La simple observation des faits de votre vie, devrait vous révéler les multiples reçus de vos nombreux dons...
Tout réside dans nos capacités à recevoir, rece-voir, nous indique reçut et vision, l'un des premiers principes est le désintéressement, comme l'oiseau ou tout autre animal, ne se préoccupe pas de savoir s'il va avoir à manger le lendemain ou le mois d'après, il vit dans l'instant présent et la nature fait en sorte qu'il est ce dont il a besoin. Si le don est fait avec intéressement, il n'est plus un don mais un achat de service. Par contre s'il est effectué sans intéressement, en ce cas, le donneur s'ouvre à la réception.
C'est le désir qui est le principal obstacle à la réception, car, a désiré en permanence des choses qui ne viennent pas en finit par se remplir de vide et par conséquent on devient a-vide...
L'autre obstacle est le mérite, d'où le désintéressement, le mérite étant un effort, il se doit d'avoir un sens, d'être juste, si vous donnez à quelqu'un qui n'attend rien, ou qui n'en manifeste pas le besoin, ce n'est pas un don, mais un débarras.
donner sans jamais rien attendre, cela ne veut pas dire donner sans mérite, ce qui serait une violation de la Justice Absolue et une imperfection.
Donné sans mérite, cultive paresse et ingratitude. Lao Tseu nous dit : qu'il ne faut pas donner le poisson à celui qui en a besoin, mais lui apprendre à pêcher. Si non cela sera de la servitude...
Citations :
Albert EINSTEIN :
La valeur d'un homme tient dans sa capacité a donner et non dans sa capacité a recevoir...
Proverbe chinois :
De même que le fleuve retourne à la mer, le don de l'homme revient vers lui.
Antoine de Saint-Exupéry :
Si l’on peut te prendre ce que tu possèdes, qui peut te prendre ce que tu donnes ?